Que va-t-il advenir des efforts à déployer continuellement pour parvenir à une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre( GES), au cours des temps à venir ? Cette question cruciale, hante en ce moment l’esprit de tous les environnementalistes. C’est que la décision du Président Trump de relancer à outrance les forages des champs pétroliers américains ne sera pas sans effets néfastes aux actions jusqu’ici menées à travers le monde pour émettre moins de carbone à partir de l’exploitation du pétrole et du gaz. La volonté d’ouvrir ici et là, de nouveaux puits pétroliers et de rouvrir ceux qui avaient été mis à l’arrêt par l’Administration américaine précédente, est la résultante d’une promesse de campagne que Dolnad Trump entend bien tenir, vaille que vaille. Tant pis pour ce qui adviendra de l’équilibre du système écologique mondial. Surtout qu’il ne se sent pas du tout concerné par l’Accord de Paris sur les changements climatiques, plutôt fait pour les autres, estime-t-il. Avec Plus de 17 millions de barils produits par jour, les Etats Unis tiennent jusqu’ici le haut du pavé dans la production pétrolière à l’échelle mondiale. A peine cette décision rendue publique par leur Président, toutes les grandes compagnies américaines impliquées dans la production pétrolière ce sont préparées à forer dans toutes les zones pétrolifères du pays. Et quel pourrait être la réaction des autres pays gros producteurs de pétrole face à ce revirement de situation des Américains. L’on imagine mal la Russie se montrer impassible à l’attitude américaine. Elle dont la vente du pétrole brut issu de ses terres, représente plus de 80% des sources de revenus de l’Etat. Elle ne se privera certainement pas de tout aussi forer plus, pour accroitre sa production. Que dire du Canada, de l’Inde , du Brésil, ainsi que de l’Arabie Saoudite. Des pays qui n’ont jamais voulu, volontairement et spontanément réduire de façon drastique leurs productions de pétrole brut, en termes de contribution efficiente à la lutte contre les changements climatiques. En Europe, plusieurs grandes compagnies comme Shell, British Petrolium ou BP en abrégé, ont aussi relancé leurs productions pétrolières. Surtout au cours de la deuxième moitié de l’année 2024. C’est qu’ils ont voulu se préparer aux conséquences économiques de cette décision de Trump, à propos de l’exploitation pétrolière, une fois qu’il retournerait au perchoir. Et ce, pour avoir compris au fur et à mesure que l’on se rapprochait de la présidentielle américaine, que sa réélection s’avérait de plus en plus probable. Les efforts financiers à faire dans le cadre de la transition énergétique, d’ici à 2030 ne sont déjà pas convenablement respectés par tous. En France par exemple l’un des pays les plus industrialisés de l’Union Européenne, c’est 5600 milliards d’euros, qu’il faut annuellement consacrer à cette transition. Alors que ce ne sont que 210 milliards qui y ont été consacrés en 2024, par les entités concernées.
Ce subit regain d’intérêt accordé à la production pétrolière ici et là, pourrait susciter une inondation du marché international du pétrole. Si c’était effectivement le cas, il devra logiquement s’en suivre, une réduction notable des cours. Ce qui ne serait certainement pas désagréable en soi, pour les utilisateurs que nous sommes des différents produits dérivés de l’or noir. Cependant, avec la survenue de cette surexploitation pétrolière qu’en sera-t-il de la quantité de carbone qui sera émise à l’échelle planétaire et que l’on s’échine depuis des années à faire considérablement baisser.
A ce jour, ils ne sont que dix pays seulement à avoir fourni à la Commission des Nations Unies sur les changements climatiques, le rapport de leurs actions menées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, rapport appelé le Plan Climat. Il doit être renouvelé tous les cinq ans et évalué par ladite Commission. Il y a fort à parier qu’à la trentième Conférence des Parties (COP), signataires de la Convention cadre sur les changements climatiques, les résultats attendus des plus gros émetteurs de GES à ce niveau par les experts, seront décevants, avec en prime celui des Etats Unis. Du fait notamment du relâchement général qui se produit depuis 2024, dans ces pays gros émetteurs de gaz à effet de serre, en matière d’actions à mener pour limiter à 1,5 degré Celsius, le niveau général du réchauffement de la planète. Or, plus personne n’ignore ou ne peut prétendre ignorer, les conséquences de plus en plus catastrophiques et chaque année plus manifestes, de la modification du climat, imputables aux gaz nocifs. Au nombre desquels, le dioxyde de carbone ou CO2 issu de l’exploitation des énergies fossiles que sont notamment le pétrole et le charbon minéral, est réputé le plus dangereux contre l’équilibre du climat.
Est-ce qu’il faut en contrepartie s’attendre à une répercussion positive de cette situation sur le marché du carbone ? Autrement dit, ces pays vont-ils, à titre compensatoire dépenser plus, pour le financement mondial des actions d’atténuation et d’adaptation aux effets des changements climatiques, comme cela est prévu ? Aucune assurance n’est pour l’heure donnée à ce niveau. Aussi, appartient-il d’ores et déjà aux pays africains et ceux situés sur les îles notamment, tous fortement victimes chaque année un peu plus des dégâts résultant des catastrophes climatiques, de mieux s’organiser pour revendiquer et obtenir ces financements compensatoires, avant la prochaine COP.
Moussa Ben Touré













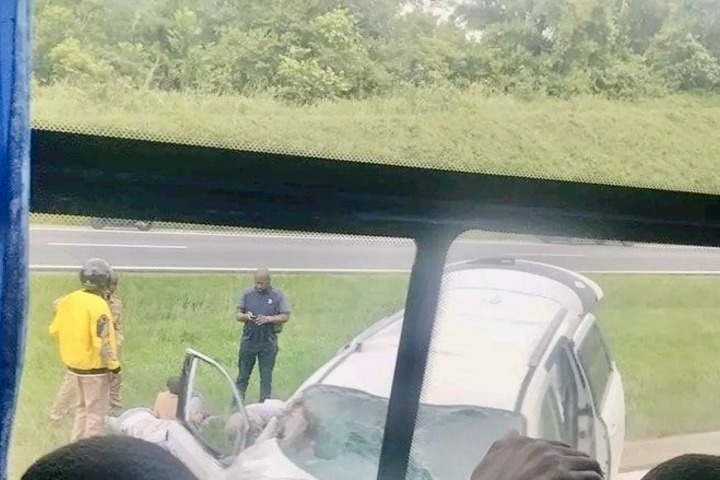






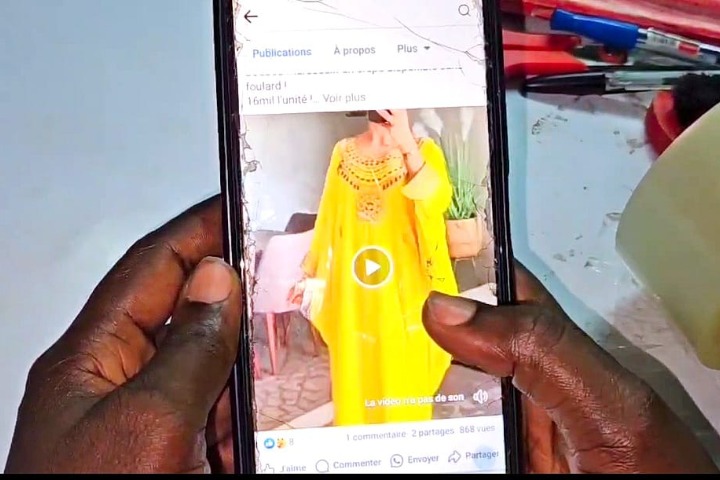








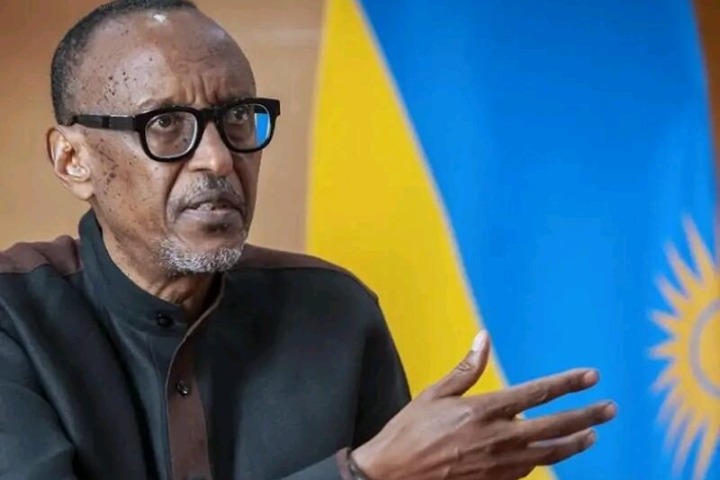



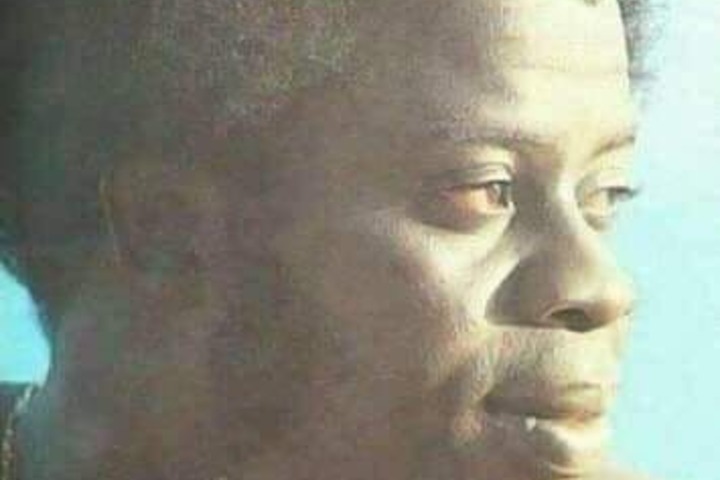












Publié le :
10 février 2025Par:
Forestier de Lahou