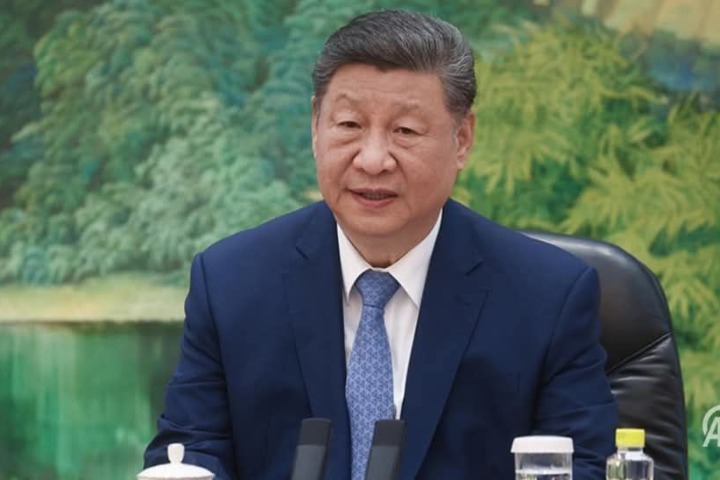« Les chemins de sa vie » (5).Du 9 au 30 mai 1962, le président Félix Houphouët-Boigny se trouve aux États-Unis d’Amérique. Avant une visite officielle qui doit commencer le 15 mai, il effectue un séjour privé dans le pays depuis le 9 mai. Pendant ces trois semaines, il n’enchaînera que les rendez-vous d’affaires, alternés, à partir de la visite officielle, avec les entretiens politiques.
Les rendez-vous d’affaires lui permettent de rencontrer l’Association nationale du café, le New York Cocoa Exchange, l’Association des manufacturiers de chocolat des États-Unis, les sociétés Westinghouse Electric International Co, Kaiser Industries, Firestone Tire and Rubber, l’Autorité du port de New York, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’USAID et plusieurs banques privées.
Les rendez-vous politiques font défiler devant lui le délégué des États-Unis à l’ONU Adlai Stevenson, la directrice adjointe pour l’Afrique de Peace Corps, Tucker Mac Evoy, le secrétaire d’État Dean Rusk, l’archevêque de New York le cardinal Francis Spellman, le maire de New York Robert Wagner, le maire de Washington Walter Tobriner, le secrétaire général intérimaire des Nations Unies U Thant, et bien sûr le président Kennedy. Félix Houphouët-Boigny qui n’est pas Léopold Sédar Senghor est même reçu par les milieux académiques et culturels. En plus de dîner plusieurs fois avec des hommes de lettres et des journalistes, il rend visite, le jeudi 17 mai à Boston, aux étudiants de l’université Harvard devant lesquels il délivre un important discours politique, avant d’être fait docteur honoris causa. Le lundi 21 mai à l’université de Pennsylvanie à Philadelphie, c’est le même programme et la même distinction, au milieu de 2000 étudiants qui recevaient leurs diplômes de fin d’année.
Comment imaginer que l’organisation de ces rencontres fameuses n’avait pas porté l’empreinte du jeune ambassadeur Henri Konan Bédié ? Ce séjour américain de presqu’un mois est apparemment le moment qui donne à Houphouët-Boigny l’occasion de vraiment bien connaître Henri Konan Bédié. S’il est ravi de son voyage, il est surtout fier de son jeune diplomate, heureux de son entregent, satisfait de son efficacité. Il ne cache pas une certaine fascination à son égard, que le concerné ne tarde pas d’ailleurs à percer à jour. « À la suite de sa visite aux États-Unis en 1962, confie-t-il, le président Houphouët avait rencontré le ministre de la Justice, Robert Kennedy, en ma présence, pour le remercier de l’accueil qu’il avait reçu. Il avait ajouté : "Je vous recommande de continuer à suivre et aider notre jeune ambassadeur car il se pourrait qu’il accède un jour à la direction de nos affaires économiques" ». C’est clair, 1962 est déjà l’année où le président conçoit de faire entrer un jour Henri Konan Bédié au gouvernement.
Un fait des immédiates années ultérieures, pertinent du point des perspectives d’Henri Konan Bédié, est sa désignation pour prononcer, le samedi 25 septembre 1965, le discours de clôture du 4ème congrès du PDCI-RDA. Savait-il qu’il inaugurait ce jour-là une tradition d’entrée automatique au gouvernement pour les militants du PDCI-RDA chargés de cette mission ? Le 31 octobre 1970, c’est Paul Akoto Yao qui aura la charge de prononcer le discours de clôture du 5ème congrès ordinaire du PDCI-RDA. Un peu plus d’un an après, exactement le 1er décembre 1971, le voilà au gouvernement, ministre de l’Éducation nationale à l’âge de 33 ans.
Le 1er octobre 1980, le jeune militant chargé de prononcer le discours de clôture du 7ème congrès ordinaire du PDCI-RDA s’appelle Alphonse Djédjé Mady. Le 18 novembre 1983, il est bombardé, à l’âge de 35 ans, ministre de la Santé publique et de la Population.
Henri Konan Bédié est l’homme qui, le 25 septembre 1965, aura inauguré cette surprenante tradition houphouëtienne. Après son discours au congrès, il n’aura que quatre mois à attendre avant d’être appelé à siéger au conseil des ministres. Le 21 janvier 1966, il doit à la fois partir de Washington, relever Raphaël Saller, le seul ministre français qui était encore au gouvernement d’Abidjan depuis l’indépendance, et seconder le ministre de l’Économie et des Finances Félix Houphouët-Boigny, comme ministre délégué aux Affaires économiques et financières.
Il se met tout de suite au travail. Et il a la main si heureuse qu’il se voit confirmé, un peu plus de deux ans et demi après, comme ministre plein. Le 23 septembre 1968, un aménagement technique du gouvernement libère le président Houphouët-Boigny de toutes les responsabilités ministérielles dont il s’était chargé depuis le déclenchement des faux complots en 1963. Dans ce cadre, Henri Konan Bédié fait partie d’un trio de membres du gouvernement qui se voient promus. Il n’est plus ministre délégué aux Affaires économiques et financières, mais ministre de l’Économie et des Finances tout court. Ses deux collègues concernés par la même évolution sont Mohamed Diawara, ancien ministre délégué au Plan, désormais ministre du Plan, et Abdoulaye Sawadogo, ancien ministre délégué à l’Agriculture, désormais ministre de l’Agriculture.
Dans les dossiers qu’il doit traiter à la tête de l’économie ivoirienne, l’un des tout premiers est celui des barrages hydroélectriques. L’électricité est, comme chacun sait, un bien essentiel pour la qualité de la vie domestique autant que pour le bon fonctionnement des usines. Bédié joue un rôle capital dans l’octroi d’un prêt américain de 36,5 millions de dollars à la Côte d’Ivoire, qui sera la première tranche du budget du barrage de Kossou.
Un autre des gros dossiers de la période est celui de la création du port de San Pedro. C’est Henri Konan Bédié qui doit en élaborer le plan de financement. Quand il considère le coût et la durée trop courte du remboursement des financements des premières offres, il s’estime tout simplement contraint de les rejeter. Et il finit par monter un programme beaucoup plus supportable pour les finances publiques ivoiriennes, grâce à une conjonction de financements français et de financements d’État à long terme de l’Allemagne fédérale.
Parallèlement à ces actions, il apporte tout son soutien à l’exécution des programmes de diversification de l’agriculture ivoirienne. On verra ainsi la production du palmier à huile et de l’hévéa, celle de la banane et de l’ananas monter en puissance et compléter harmonieusement le café et le cacao, dans la gamme des produits d’exportation de la Côte d’Ivoire.
Même les sociétés d’État que leur gestion désastreuse avait fini par désigner à la vindicte du monde entier étaient des initiatives que lui, Konan Bédié, appréciait différemment, pour des raisons qui ne manquaient pas de pertinence. « La Côte d’Ivoire, expliquait-il, n’aurait pas accédé à son niveau actuel de développement sans ces sociétés d’État. Il n’y avait rien auparavant. L’épargne n’existait pas et les investisseurs se comptaient sur les doigts de la main. Un pays nouvellement indépendant n’attire pas du jour au lendemain les investissements. (…) C’était donc à l’État de prendre des initiatives et nous l’avons fait en créant des sociétés de développement. (...) C’est ce qui a permis le succès actuel des privatisations, car il ne faut pas oublier que ce sont ces "Sode" que l’on privatise. Qu’elles aient été mal gérées s’explique aisément. L’État, en les créant, n’avait pas pour objectif de faire des profits. Il s’agissait de créer des activités, d’occuper la population, de lui fournir des revenus et de donner des emplois aux cadres. Au moment où le FMI et les autres agences de développement sont venus discuter du plan d’ajustement structurel, les Sode employaient plus de quarante mille personnes. Conséquence automatique, même si de nombreux employés sont restés au sein des nouvelles sociétés privatisées, des milliers ont été licenciés lors des dégraissages. Cette situation n’est pas propre à la Côte d’Ivoire. Lorsqu’un État monte une entreprise, il est plus intéressé par la création des emplois que par la rentabilité financière et les dividendes. Deux logiques qui ne se rejoignent que rarement… » Comment ne pas entendre ce raisonnement aujourd’hui ?
Ces fameuses « Sode », c’était l’une d’entre elles, la Sodesucre, consacrée au programme sucrier du nord de la Côte d’Ivoire, qui offrirait à Houphouët-Boigny le prétexte pour évincer Henri Konan Bédié de ses responsabilités gouvernementales. Pour le président, la construction de la Sodesucre entrait dans une vaste opération d’aménagement du territoire dont le but était d’améliorer, comme dans le Sud, le cadre de vie du Nord. Les unités Sodesucre, avec les créations de villages, de routes et de ponts qui les accompagneraient, devaient s’accorder avec les initiatives agro-industrielles relatives à l’anacarde et au coton-fibre, et avec les aménagements hydro-agricoles réclamés par la Soderiz pour propulser le Nord dans les temps modernes. L’une des constantes de la politique de votre Parti et de votre gouvernement, disait-il le 18 mars 1974 à Korhogo, est de réduire, tout comme les inégalités sociales, les disparités de développement entre régions. Nous voulons que sous peu, on ne puisse plus, en Côte d’Ivoire, parler sans mauvaise foi de la vitrine du littoral et de l’arrière-boutique du Nord.
Houphouët-Boigny, porté par cet enthousiasme, n’admettrait aucune objection à ses initiatives pour le Nord. Cette prise de parole du 18 mars 1974 à Korhogo n’était que la première d’un chapelet entier d’interventions, prévues pour rythmer les nombreuses étapes d’une tournée qui le mènerait, jusqu’au 29 mars, à Sirasso, Dikodougou, Napiéolédougou, M’Bengué, Sinématiali, Gbon, Tingréla, Boundiali, Ferkessédougou, Ouangolodougou, Niellé et Kong. Partout, c’était le même couplet de la Sodesucre qui devait servir à un nécessaire rééquilibrage du développement en faveur du Nord.
C’était une approche qu’Henri Konan Bédié ne partageait pas totalement. Lui, en effet, avait les yeux rivés sur le poids de plus en plus volumineux de la dette ivoirienne, et cela le poussait à se montrer plus prudent. Il a expliqué que « quand le président Houphouët a parlé de l’implantation d’un programme de complexes sucriers dans le Nord, à Ferkessédougou, toutes les régions de la savane ont réclamé le même. Certains étaient allés dire au président : "Vous comptiez construire trois complexes sucriers de cent mille tonnes mais pourquoi ne pas couper ces unités en deux, ce qui vous permettrait de toucher un plus grand nombre de régions de Côte d’Ivoire ?" Il a accepté. Nous devions construire dix sucreries, mais nous nous sommes arrêtés à six, à cause des coûts. Elles étaient implantées dans des régions totalement enclavées où il fallait construire des routes, installer l’électricité, édifier l’habitat des travailleurs. Ce projet sucrier de Ferkessédougou prévoyait par exemple la construction d’un village pour loger les ouvriers et amener la bretelle du chemin de fer pour drainer la marchandise vers les rails proches. (…) J’étais très réservé sur ce programme et j’ai mis en garde le président Houphouët, verbalement, mais aussi par écrit en lui disant notamment : "Monsieur, vous ne pouvez tout au plus que construire deux unités, compte tenu de l’incidence sur la dette." (...) Non seulement je n’ai pas été entendu, mais il m’a même rabroué. "Si on était contre ma politique, on ne s’y prendrait pas autrement", m’a-t-il rétorqué. J’ai été très secoué ce jour-là, car je l’aimais beaucoup et je tenais à mériter sa confiance. »
Quand l’échec de la Sodesucre est devenu patent, le ministre a été jeté en pâture à l’opinion publique, accusé d’avoir procédé à une surfacturation du projet. Or si un programme initial de trois unités a été inconsidérément envisagé pour dix, avant de se fixer à six et de s’alourdir de réalisations annexes aussi importantes que des programmes d’électrification et des constructions de villages, de routes et de ponts, comment éviter objectivement une explosion de l’enveloppe initialement prévue ?
Ce qu’on retient aujourd’hui, dans tous les cas, c’est que les choix de politique économique qui avaient été ceux d’Houphouët-Boigny et de Konan Bédié à cette époque-là n’étaient pas insensés, même s’ils ont été souvent critiqués et parfois à juste raison. C’est l’impressionnant développement connu par le pays sous la direction des deux hommes qui assurait encore sa survie à la Côte d’Ivoire des années de la turbulence, alors que la crise ouverte par le coup d’État de 1999 et par la guerre de 2002 avait tout simplement rendu impossibles, pendant plus de dix ans, tout investissement significatif et tout progrès supplémentaire dans notre pays. Frédéric GRAH MEL