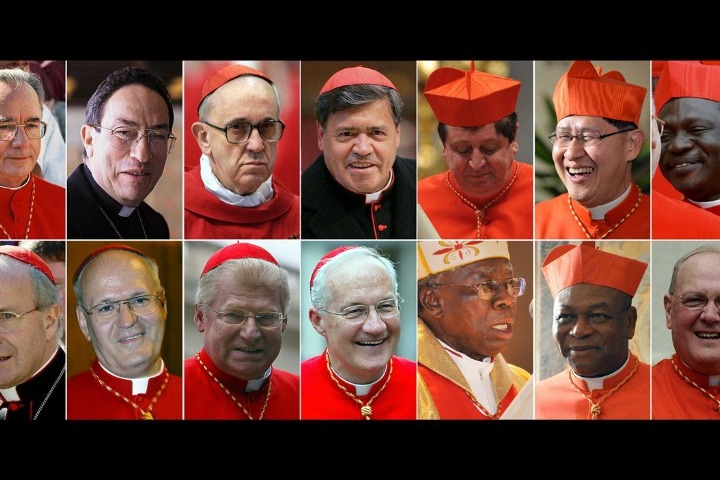«Les coronavirus sont très forts pour s’installer dans une population», rappelle Astrid Vabret, virologue à l’hôpital de Caen. A l’heure où tout le monde se demande comment va évoluer le Sars-Cov-2, responsable du Covid-19, cette spécialiste des coronavirus nous parle des six autres virus de cette famille connus pour infecter l’être humain. Quatre d’entre eux sont particulièrement méconnus et pourtant encore très présents. NL63, 229E mais aussi OC43 et HKU1 sont quatre coronavirus endémiques chez l’homme. Ils sont responsables de 15 à 30 % des rhumes hivernaux, et depuis longtemps pour certains. «On situe l’émerge de NL63 au XIIIe siècle et celle de 229E à la fin du XIXe», détaille Astrid Vabret.
Les premiers coronavirus humains ont été identifiés dans les années 60. Pour connaître leurs effets, des scientifiques les ont inoculés à des volontaires sains. «Les résultats sont intéressants par rapport à ce que l’on a vu durant cette pandémie. La moitié des volontaires ont développé des symptômes après trois jours d’incubation. Les autres ne sont pas infectés ou asymptomatiques», explique Astrid Vabret.
Les symptômes en question se limitant à des infections des voies aériennes hautes, c’est-à-dire des rhumes, les fonds n’ont pas afflué pour financer des recherches sur ces coronavirus. Quelques cas d’infections des voies aériennes basses (bronches, poumons) ont bien été détectés, mais pas de quoi exciter les médecins. Pourtant, ces coronavirus ne sont pas sans danger. «Chez des personnes immunodéprimées, ils peuvent déclencher des formes graves. Les personnes récemment greffées peuvent en mourir», alerte Astrid Vabret.
Comment sont apparus ces 4 coronavirus endémiques ?
«Ces virus ont pu être, lors de leur introduction chez l’homme, des virus assez sévères. Au cours du temps, leur pouvoir pathogène a pu s’amoindrir», avance Hubert Laude, figure de la recherche sur les coronavirus en France.
Il n’existe cependant pas de trace d’une grande épidémie d’infection respiratoire dans les années 50, par exemple, lors de l’apparition supposée de HKU1. «Mais à cette époque une telle épidémie peut passer inaperçue», avance Astrid Vabret.
L’apparition d’OC43 est, elle, au cœur d’un débat scientifique. Certains le soupçonnent d’être l’agent responsable de ce que l’on a appelé la «grippe russe» de 1890. Partie de Russie, la maladie, une atteinte respiratoire, touche Saint-Pétersbourg en 1889 et se répand le long des voies de chemin de fer, mais pas seulement, puisqu’elle atteint aussi les Etats-Unis ou encore l’Australie. La pandémie, longtemps attribuée à un virus de la grippe, reviendra par vague jusqu’en 1895 et aurait fait un million de morts à l’époque. Des éléments nouveaux pointent vers la responsabilité du coronavirus OC43.
L’analyse du génome de ce dernier plaide en effet pour un passage des bovins à l’homme contemporain de cette crise. Par ailleurs, en regardant les rapports médicaux de l’époque, les chercheurs Harald et Lutz Brussow notent des similarités troublantes avec le Covid-19. Ils relèvent ainsi des descriptions d’«affections multisystémiques comprenant des symptômes respiratoires, gastro-intestinaux et neurologiques, y compris la perte de la perception du goût et de l’odorat», mais aussi «une récupération prolongée ressemblant à de longues observations de Covid». Ou encore que la mortalité porte sur les personnes âgées alors que les enfants sont peu affectés.
«Nous n’aurons sans doute jamais de preuve définitive de cette hypothèse. Mais elle est plausible et montrerait que le passage d’un virus épidémique à un virus endémique est possible», conclut Hubert Laude.
Les épidémies de Sras et de Mers
Deux autres coronavirus ont bel et bien été à l’origine d’épidémies avérées. Il s’agit du Sras, en 2003, et du Mers, en 2012.
«Quand le Sras arrive en 2003, le fait qu’il s’agisse d’un coronavirus est une grosse surprise. On savait peu de choses sur eux à l’époque. HKU1 et NL63 n’avaient pas encore été identifiés», rappelle Astrid Vabret.
L’épidémie fera 8 000 cas et 800 morts, essentiellement en Chine et à Toronto. «Une des différences importantes avec le Sars-CoV-2, c’est que la contagiosité commence moins en amont des signes cliniques», avance Astrid Vabret pour expliquer la plus faible diffusion du virus. «Et il ne faut pas oublier les mesures de santé publique drastiques mises en place par la Chine à l’époque», complète-t-elle.
L’histoire du Mers est différente puisque ce virus continue d’être présent. «En dehors de quelques surpertransmissions interhumaines, il s’agit surtout de réintroductions sporadiques à partir du dromadaire», explique Hubert Laude. Justement, les supertransmissions, ces moments où une personne en infecte beaucoup d’autres en peu de temps, jouent un rôle important dans la dynamique du Covid-19.
En août 2015, un patient revenu de la péninsule arabique débarque en Corée du Sud avec une infection. Il ira dans un, puis deux, puis trois, puis quatre hôpitaux avant de recevoir le bon diagnostic. «Il a été l’origine de 186 cas dont 36 décès. Dans le troisième hôpital qu’il a fréquenté, 900 personnes ont été exposées et 80 sont tombées malades. Cela montre comment une épidémie peut vite monter en flèche dans un système de santé insuffisamment préparé», commente Astrid Vabret.
La vaccination, les poules et le coronavirus
Face au Sars-CoV-2, en l’absence de traitement efficace et aisément administrable, la vaccination est pour l’heure la seule stratégie de sortie de crise. Pour le coup, aucun vaccin contre les autres coronavirus humains n’existe. Par contre, il y a eu beaucoup de tentatives d’en mettre un au point chez les animaux. Les coronavirus sont responsables de diverses maladies affectant le poumon, les intestins ou le système nerveux chez les poules, le porc ou les bovins, notamment.
«Pendant longtemps, aucun projet de vaccin n’aboutissait. A tel point que j’étais très sceptique sur la faisabilité d’un vaccin chez l’homme, en tout cas rapidement. Les faits m’ont donné tort, heureusement», reconnaît Hubert Laude.
Il existe bien un vaccin vétérinaire efficace. Il protège contre la bronchite infectieuse aviaire chez la poule. «C’est un vaccin délivré par aérosol. Il permet de limiter les formes graves de la maladie», explique Hubert Laude. Ces autres caractéristiques rappellent quelque chose dans le débat actuel sur la vaccination contre le Covid-19. «Il permet de contrôler la maladie mais pas de l’éradiquer. En effet, il n’empêche pas complètement l’infection et il faut mettre à jour le vaccin chaque année en fonction des virus circulants», explique Hubert Laude. Comme une prémonition pour l’avenir du Covid-19 ? Pas sûr, après tout, on n’est pas des poules.
Olivier Monod